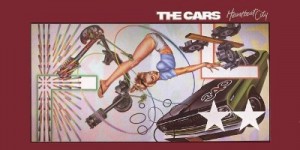24
03/15
Le pompon du piratage
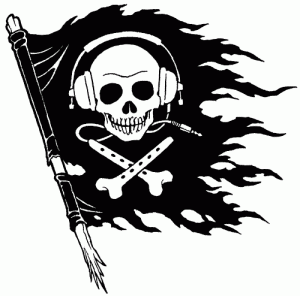 Panique à Valence ! La police vient de démanteler dans cette bourgade de la Drôme, un trafic juteux de décodeurs pirates. Les pirates de Canal + seraient, dans la région, plusieurs centaines, tous liés à un «noyau dur» de salariés de l’entreprise locale d’électronique Crouzet. Les policiers de Valence ont effectué récemment des perquisitions au domicile d’une trentaine de techniciens et ingénieurs, et procédé à l’interpellation de quatre personnes. Valence tient le pompon pour le piratage de Canal +. Il y a un an déjà, une filière du même type avait été démantelée. Le décodeur était vendu 1 300 francs l’unité, par l’intermédiaire d’un magasin d’électroménager.
Panique à Valence ! La police vient de démanteler dans cette bourgade de la Drôme, un trafic juteux de décodeurs pirates. Les pirates de Canal + seraient, dans la région, plusieurs centaines, tous liés à un «noyau dur» de salariés de l’entreprise locale d’électronique Crouzet. Les policiers de Valence ont effectué récemment des perquisitions au domicile d’une trentaine de techniciens et ingénieurs, et procédé à l’interpellation de quatre personnes. Valence tient le pompon pour le piratage de Canal +. Il y a un an déjà, une filière du même type avait été démantelée. Le décodeur était vendu 1 300 francs l’unité, par l’intermédiaire d’un magasin d’électroménager.
Nouveau boîtier rs 80
 Proposé par RS 80, le V 22 est un boîtier de connexion automatique avec détection électronique. Il permet de relier un téléviseur, deux magnétoscopes, un décodeur Canal +. Avec lui, vous pouvez enregistrer Canal + TV éteinte, regarder Canal + et enregistrer une autre chaîne, regarder un programme différent et enregistrer Canal +, regarder Canal + tout en l’enregistrant. Mais vous pouvez enregistrer deux programmes différents simultanément tout en regardant un troisième, regarder une cassette sur un magnétoscope et enregistrer n’importe quelle chaîne sur un deuxième appareil, ou encore, copier une cassette sur l’un des deux scopes tout en regardant la cassette ou un programme TV et la détection Canal + est automatique. Le boîtier est livré complet avec les cordons de liaison quel que soit le type de magnétoscope. Vendu dans les FNAC, Darty, Nasa, Photo-Ciné du Cirque, le V 22 vaut 2 390 F. Rens. : 47.01.16.12.
Proposé par RS 80, le V 22 est un boîtier de connexion automatique avec détection électronique. Il permet de relier un téléviseur, deux magnétoscopes, un décodeur Canal +. Avec lui, vous pouvez enregistrer Canal + TV éteinte, regarder Canal + et enregistrer une autre chaîne, regarder un programme différent et enregistrer Canal +, regarder Canal + tout en l’enregistrant. Mais vous pouvez enregistrer deux programmes différents simultanément tout en regardant un troisième, regarder une cassette sur un magnétoscope et enregistrer n’importe quelle chaîne sur un deuxième appareil, ou encore, copier une cassette sur l’un des deux scopes tout en regardant la cassette ou un programme TV et la détection Canal + est automatique. Le boîtier est livré complet avec les cordons de liaison quel que soit le type de magnétoscope. Vendu dans les FNAC, Darty, Nasa, Photo-Ciné du Cirque, le V 22 vaut 2 390 F. Rens. : 47.01.16.12.